Parution : Saint Jean, l’évangile à méditer en filet
L’évangile à méditer en filet
Françoise Breynaert, Jean, l’évangile en filet, Parole et Silence, 8 décembre 2020, 28€, 460 pages.
Voici une exégèse complète de l’évangile selon saint Jean, et même révolutionnaire au sens où elle prend au sérieux ce que les Chrétiens de l’Eglise araméenne de l’Orient ont toujours dit (mais qu’on n’écoute pas encore vraiment en Occident) !
Elle rend enfin accessible à tous, pas à pas, l’oralité particulièrement riche de cet évangile composé par l’apôtre en araméen à la manière d’un filet, c’est-à-dire en vue d’être médité selon la lecture horizontale habituelle, ou verticale, ou même autre encore : c’est le secret encore trop méconnu de sa structure. Ces diverses lectures révèlent des aspects insoupçonnés ou seulement entrevus du mystère du Christ et de celui de l’histoire.
Elles font redécouvrir en particulier le vrai sens de l’histoire, qui est révélé et qui est encore si méconnu aujourd’hui..
Au début de ce livre d’exégèse, on trouvera une longue introduction présentant la question de l’oralité, d’abord en général, puis relativement aux trois évangiles synoptiques, et enfin à la logique de composition propre à Jean.
Pour comprendre celle-ci, Fr. Breynaert retrace alors les trois étapes de sa formation :
♦ le témoignage premier de Jean (en alternance avec Pierre) et ses récitatifs,
♦ la première structuration en collier « filet » (beaucoup d’exégètes ont subodoré en effet
l’existence de deux étapes),
♦ et la structuration en « filet » définitif, actuel.
Un Prologue, ou «shouraya» araméen, introduit aux diverses lectures de l’évangile, tandis que le fameux chapitre 17 dit « sacerdotal » constitue son «houtama» (ou épilogue qui «scelle»).
Cette étude s’enracine dans la lignée des recherches françaises du P. Marcel Jousse puis de Pierre Perrier, comme le rappelle dans la préface Mgr Thomas Yousif Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Sulaimanyah (Irak) :
« Ce livre constitue un cadeau au bon moment. Il nous ramène à l’essentiel de ce qui a fait le fondement du Christianisme : c’est la parole – le récit – qui faisait foi. Ce récit est transmis par une communauté vivante. Et malgré tous les malheurs qui vont se succéder ultérieurement, cette parole va se maintenir. […]
L’analyse que fait Françoise Breynaert est en continuité avec la démarche importante mais balbutiante du début des années 1960 (P. Marcel Jousse), et qui prend force de nos jours, quoiqu’elle soit combattue par certains « spécialistes » académiques. Elle est un peu en dehors des sentiers battus ou même marginale, « sans fondements » aux yeux de certains. Mais pour ceux qui s’y penchent, sans aprioris idéologiques, c’est une découverte de nos traditions syro-chaldéennes, une révélation étonnante qui éveillera certainement toujours plus d’intérêt, encore et encore. »
________________________
Note :
Une des choses que « Jean, l’évangile en filet » met en lumière est la solide structuration de la foi chrétienne dès le temps des apôtres, et l’unité de foi qui leur est commune. Ceci apporte une réponse implicite au livre qui est paru juste auparavant en octobre, un livre impressionnant par son gabarit luxueux (20 x 27 cm, 704 pages), chez Albin Mic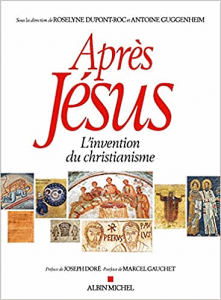 hel : Après Jésus, l’invention du christianisme, sous la direction de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim, 49 €. Ce livre a reçu des subventions du Centre National du Livre. Les livres chrétiens seraient-ils soutenus tout-à-coup par le Ministère de la Culture ? Il convient d’y regarder de plus près…
hel : Après Jésus, l’invention du christianisme, sous la direction de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim, 49 €. Ce livre a reçu des subventions du Centre National du Livre. Les livres chrétiens seraient-ils soutenus tout-à-coup par le Ministère de la Culture ? Il convient d’y regarder de plus près…
On y trouve les articles de 72 auteurs, dont seuls deux, au chapitre 21, abordent le christianisme « syriaque », donc à l’intérieur de l’empire romain, et zéro relativement au christianisme hors de cet empire. Comme on le comprendra plus loin, il existe un lien entre cette discrétion et la thèse avancée par l’ouvrage, celle d’un christianisme se séparant progressivement du « judaïsme » et s’intégrant lentement dans le monde gréco-romain, par l’invention progressive de son identité propre, de son contenu de foi, et de son orthodoxie. Cette thèse n’est pas originale, elle est même très habituelle dans de nombreux milieux.
Du point de vue de la langue, l’idée de « l’invention du christianisme » se fonde sur la prise en compte du seul grec, l’usage d’autres langues étant nécessairement tenu pour tardif (sinon cela ne marche pas). Ainsi, lit-on à la page 53, « l’expansion du christianisme » au-delà des frontières de l’Empire daterait du 3e siècle, « les chrétiens ayant commencé à utiliser » le latin à la fin du 2e siècle, et le syriaque au début du 3e siècle seulement, et le copte à la fin du même siècle, l’arménien au 5e siècle et d’autres langues plus tard encore. Sur quoi se basent ces affirmations ? Ce n’est dit nulle part, mais en tout cas pas sur l’exégèse, car tout étudiant sait que l’ancienneté d’un texte ne se tire pas simplement de l’existence aujourd’hui de tel ou tel manuscrit, mais de sa valeur intrinsèque et comparée. Par ailleurs, il est prouvé que l’islam a détruit systématiquement la plupart des bibliothèques non arabes qu’il trouvait sur son chemin. Quelles langues parlaient donc les nombreux chrétiens d’Egypte (en dehors d’Alexandrie), de Mésopotamie ou de contrées plus lointaines en Asie centrale, en Inde etc. ? On ne le saura pas grâce au livre – ou alors il faut supposer qu’ils ne devaient pas exister.
Derrière ces questions, la thèse avancée est celle de la fabrication d’un christianisme qui ne devrait pas grand-chose à Jésus, « hormis un repas en mémoire de lui, et une prière, le Notre Père » hérités de lui, lit-on sur la page IV de couverture. Le reste a été « inventé » , ce qui demande du temps, et la présentation chronologique (pages 21-22) annonce péremptoirement : composition de l’évangile de Marc en 71, ceux de Matthieu et Luc entre 80 et 85, et celui de Jean en 98. En 40 ou 68 ans, on a ainsi le temps « d’inventer » – en grec évidemment.
Neuf pages seulement sont consacrées au christianisme non grec ; encore s’agit-il des chrétiens syriaques vivant dans les limites de l’Empire, les Coptes n’existant pas encore, ni sans doute les chrétiens araméens et autres présents dans l’Empire parthe. Françoise Briquel-Chatonnet parle même d’une « mise en scène » de la « conversion au christianisme » remontant à l’apôtre Thomas par ces chrétiens d’Orient (p. 570). Ces derniers doivent donc être de gros menteurs.
Indiquant sans plus que « le christianisme se diffuse le long des routes de commerce » (p.567) – ce qui demande du temps si c’est en soi grâce au commerce –, cette historienne n’a pas compris qu’il s’est diffusé dans et grâce aux communautés juives présentes dans toutes les villes des routes de la soie par terre ou mer (et même dans d’autres directions pour la même raison), et que cette diffusion commencée par les apôtres eux-mêmes et leurs disciples est donc allée très vite ; justement, il n’y a pas un seul article du livre qui traite de la présence juive partout dans le monde antique, une présence qui est bien antérieure à la première guerre juive, la plupart des juifs (presque 3% de la population mondiale selon les estimations du rabbinat de New York) ne vivant déjà plus en Palestine romaine.
Sous la plume de Muriel Dubié, on lit une remarque intéressante : « Le Saint-Esprit, mot féminin, n’est devenu masculin qu’au 5e siècle sous l’influence de la théologie grecque » (p. 582). Effectivement. Encore aurait-il été intéressant de préciser que, chez les chrétiens parlant araméen aujourd’hui encore (Chaldéens et Assyriens), langue du Christ et des apôtres… et langue officielle de l’Empire parthe (!), ce mot « ruha’ » est resté féminin. L’auteur ne semble pas s’en soucier, puisqu’il affirme que « dès 170, on traduisit les évangiles du grec en syriaque » (p. 576), c’est-à-dire que le christianisme syro-araméen ne devait pas exister auparavant puisqu’il n’avait supposément pas de texte évangélique propre. D’autres de ses écrits montrent qu’il est prudent sur cette cette thèse qu’il suggère là, mais en tout cas celle-ci est assez clairement partagée par la plupart des auteurs impliqués dans l’ouvrage (dont de nombreux sont juifs).
En matière archéologique, dans un des deux articles de M-F Baslez, on trouve des renseignements intéressants sur la maison de Doura-Europos qui servait de lieu de culte chrétien (avant 256, année de la destruction de la ville), et d’une autre beaucoup plus ancienne, découverte en 2005 sur le site de Kefar Othay, aux confins de la Samarie et de la Galilée, lieu de la 6e légion romaine – des officiers de cette légion étaient donc chrétiens (p. 59-61). C’est maigre.
Même concernant le christianisme dans l’Empire romain, le livre est gravement lacunaire. On n’y trouve pas un mot des vestiges chrétiens trouvés à Pompéi et à Herculanum. Concernant Pompéi, il s’agit de :
• une croix gravée en relief sur un mur (découverte en 1813-1814)
• une inscription murale parlant de chrétiens (découverte en 1862)
• et deux exemplaires du fameux cryptage en palindrome appelé « carré magique » ou « carré Sator », basé sur l’association des lettres A-O (le même, mais datant du 2e siècle, a été trouvé à Budapest, et le 3e siècle nous en a laissé un en Angleterre et quatre sur l’Euphrate).
Concernant Herculanum, il s’agit de la croix murale de la « villa du bicentenaire » autour de laquelle les trous de clous et la zone plus claire suggèrent la présence de portes en bois léger ou au moins d’un encadrement portant un voile, afin de dissimuler aux regards la croix fixée ou gravée sur le mur.
Comme sa voisine Pompéi, la ville avait été ensevelie en l’an 79 par les cendres et la lave surgies du Vésuve. Les vestiges sont donc antérieurs à 79, ce qui est sans doute trop tôt aux yeux de certains ; ils ne peuvent donc pas avoir existé.
De même, n’auraient pas existé non plus la lettre d’Appolonius à Ammonius, le 7Q5 (ms 7 de la grotte 5 de la mer Morte), les allusions du Satiricon de Pétrone Niger (vers 61), du Cariton, etc.
On notera encore cette affirmation péremptoire : « l’absence d’images spécifiquement chrétiennes de par leur contenu, leur style et/ou leur destination au cours des deux premiers siècles de l’ère commune est un fait incontestable » (p. 68, F. Boespfug, aidé par E. Foglidiani). Ce qui précède indique déjà le contraire, sans parler de représentations de la Vierge Marie. On raconte ainsi que « le christianisme des origines fut très marqué par l’aniconisme juif » (p. 69) – ce qui est un certain anachronisme car les juifs de ce temps représentaient des plantes et des animaux et même des personnages tels que Abraham ou Isaac comme on le voit dans la synagogue de Doura Europos.
Notons que, concernant la croix, il est généralement dit que, comme rappel d’un supplice affreux, elle n’a pas pu être représentée avant longtemps, mais c’est oublier qu’elle a été interprétée tout de suite comme la réalisation du signe du tav (cependant, pour le savoir, il faut s’intéresser au monde judéo-araméen) ; les représentations de la croix à Herculanum et Pompéi s’expliquent très bien.
Selon ce qu’indique le sous-titre de l’ouvrage, la thèse à démontrer est celle de « l’invention du christianisme », ce qui suppose une progressivité et un temps long. Il faut noter qu’une telle thèse a beaucoup de sens relativement à l’islam, la figure de Muhammad et le texte coranique n’étant pas des à-côté. Or, cette figure de Prophète, le Coran que celui-ci est supposé avoir dicté et la lecture qui en est faite sont aujourd’hui démontrés comme étant des fabrications mises au point sur au moins deux siècles – à condition cependant de garder à l’esprit la permanence d’un substrat antérieur, hérité des initiateurs judéo-nazaréens. On parlera donc à juste titre d’une « invention de l’islam ».
Cette thèse pourrait-elle s’appliquer également au « judaïsme » en tant que concept anachronique au temps de Jésus ? Il faut remarquer en effet qu’il n’existait pas alors d’unité doctrinale parmi les juifs ; et ce qu’on appelle aujourd’hui « le judaïsme » s’est constitué plus tard comme continuation radicalisée (et anti-judéo-chrétienne) du seul mouvement pharisien, en prenant forme peu à peu à Babylone. Ce « judaïsme » ne s’imposera d’ailleurs à l’ensemble du monde « juif » que plus de mille ans plus tard (les juifs de Khazarie, ancêtres des Ashkénazes, étaient farouchement opposés aux Talmud-s, c’est-à-dire au judaïsme constitué autour des rabbins babyloniens).
Quant au christianisme, peut-on parler d’une fabrication progressive (gréco-latine) ?
Cette idée va de pair avec celle du christianisme comme produit de définitions dogmatiques (gréco-latines), lesquelles furent mises au point progressivement. Mais c’est confondre le poteau indicateur et la route. Une telle erreur, très intellectualiste, se nourrit d’un présupposé et d’une occultation : d’une part il faut que le christianisme ait été un rejeton gréco-latin du « judaïsme » (ce qui présuppose un « judaïsme » uni, originel et immuable jusqu’à nos jours), et il faut d’autre part qu’il n’ait été que cela – ce qui rend très gênante l’existence des Eglises sémitiques de l’Orient depuis le temps des apôtres, elles qui ont conservé les traditions hébréo-araméennes. En fait, elles étaient constituées d’abord de descendants de juifs qui, de manière majoritaire au moins en Mésopotamie, ont suivi les Apôtres (et elles sont bien vivantes aujourd’hui).
Une dernière remarque : il n’est sans doute pas fortuit que le co-directeur de l’ouvrage, le Père Antoine Guggenheim, soit membre du comité éditorial de la revue des Etudes du Crif, et participe à de nombreuses émission de la radio juive de Paris. On fera attention aussi au cours qu’il a donné le 3 mai 2014 aux Bernardins, « Est-ce que la foi en la résurrection de la chair est importante ? » , spécialement à partir de 16′ 30′′ . Il y explique que la résurrection, c’est croire en la résurrection, le miracle se passant dans le croyant qui croit. Pour sa part, Mgr Gaillot, de manière moins intellectuelle, expliqua un jour à la télévision que la Résurrection, c’est croire qu’après la pluie viendra le beau temps, il faut toujours garder l’espérance. En d’autres mots, les récits de la résurrection auraient été créés pour exprimer cette espérance sous forme de mythe. Il suffisait d’y penser. Les voltairiens y avaient pensé déjà au 18e siècle. C’est d’ailleurs à eux que l’on doit, sous sa forme moderne, l’idée de « l’invention du christianisme ».
Edouard M. Gallez


Commentaires très intéressants et pertinents.
D’autant plus pour moi que je me suis procuré les deux volumes.
Il aurait par contre été intéressant que ces recensions soient signées.
Qui est l’auteur de ces commentaires?
Merci!