Extraits de Thomas fonde l’Eglise en Chine (2008)
Extraits de :
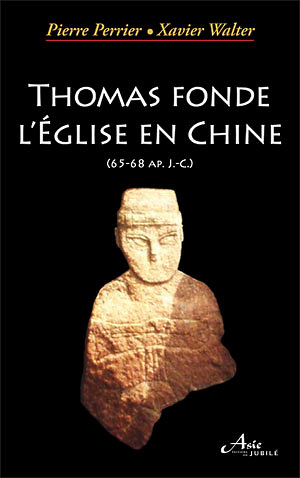 Perrier Pierre et Xavier Walter, Thomas fonde l’Eglise en Chine (65-68), Paris, éd. du Jubilé, 2008. (autre introduction)
Perrier Pierre et Xavier Walter, Thomas fonde l’Eglise en Chine (65-68), Paris, éd. du Jubilé, 2008. (autre introduction)
___Le livre se présente comme une vaste et passionnante enquête qui emmène le lecteur de découvertes en découvertes – celles que les auteurs ont faites eux-mêmes – dans les domaines de l’histoire chinoise (les fameuses chroniques impériales), de la géographie, de archéologie, etc. Le point de départ fortuit de l’enquête, outre des rencontres inattendues faites en Chine, était cette photo étonnante mais de mauvaise qualité que l’on trouvait sur le web dans certains sites chinois dédiés au tourisme :
___Il s’agit de deux des trois plus grandes sculptures que l’on sait datées de l’an 70 ; la falaise où elles sont gravées se trouve à la sortie du port de Lianyungang sur la route menant à la capitale impériale de l’époque, Luoyang. Des recherches complémentaires ont abouti à une compréhension des dizaines d’autres personnages représentés en beaucoup plus petit. Heureusement, des dessins précis ont été faits avant le mois de mai 2009, au cours duquel les autorités chinoises ont fait sabler (donc gommer) la paroi, effaçant les gravures de peu de relief. Des bas-reliefs vieux deux mille ans, s’ils sont parsemés de mousses, on les nettoie à la brosse à dents, pas au karcher. Il s’agit d’un vandalisme archéologique. Des bas-reliefs bouddhistes auraient-ils subi un tel manque de soin ?
________________________________
EXTRAIT 1 : (p.55-57)
“Tout était à reprendre et à clarifier dans un ensemble heureusement important de traditions recueillies par le monde bouddhiste. Il fallait redistribuer faits et signes conservés, les uns par la tradition liée à la première mission (pour nous chrétienne), à compter de la date du sonde de l’empereur Mingdi, en 64-65 ; les autres, par le souvenir d’une seconde mission, postérieure de près d’un siècle, parvenue à Luoyang sous l’empereur Han Andi, après les accords avec les Kouchans, suite aux opérations militaires, dans les années 90, puis les années 120, des généraux Ban Chao et Ban Yong. C’est à cette redistribution que nous nous sommes attelés après avoir découvert, dans le troisième personnage de Kong Wang, une femme, l’argument essentiel d’une figure qui sera, elle, incorporée progressivement dans le bouddhisme chinois.
Quel transfert religieux et quelles traces ?
Un examen plus attentif de la photographie de la troisième figure de Kong Wang révéla qu’il s’agissait d’une femme allongée sur un lit, appuyée sur un coussin, et qui portait sur elle un petit enfant enveloppé de langes. De sa main droite, elle le désignait à l’observateur. Son mouvement était d’une configuration iconographique spécifique évidente, conforme exactement aux Nativités orientales traditionnelles, telles qu’elles seront représentées par la suite: la Vierge y présente toujours L’Enfant nouveau-né à l’adoration des fidèles. Cette scène obéit au modèle iconographique (initialement païen) en usage courant chez les Parthes au 1er siècle : il est introduit sous cette forme précise par les artistes du courant artistique qui s’épanouit alors dans le Nord du golfe Persique, à proximité du port[1] d’où appareillaient les bateaux à destination de l’Inde du Sud, avec ses passagers et marchandises en quête éventuelle d’un relais vers la Chine et le Japon. Ces artistes ciselaient des bas-reliefs sur des parois rocheuses verticales représentant en général un couple de prêtres debout, à côté d’une divinité assise. Le golfe était le débouché commercial naturel du nord du pays (l’Assyrie) – qu’avait d’abord évangélisé l’apôtre Thomas qui avait prêché à Ninive en compagnie de l’apôtre Nathanaël-Barthélemy dans les années 40 – et du sud (la Chaldée) du « Pays des deux fleuves », en grec: la Mésopotamie où évangélisait l’apôtre Jude.
Une trace associée à une miséricorde absente du « Petit Véhicule »
Par cette origine, on comprend d’autant mieux pourquoi une représentation de Marie à L’Enfant a été sculptée sur cette paroi dans les années 60 que le 15 Ab (août) de l’année 51 est la date traditionnelle de l’Assomption de Marie, à Jérusalem. Or, selon la tradition, Thomas s’y est replié, depuis Pattala, dans le delta de l’Indus, où la guerre l’a surpris. Il arrive à Jérusalem après l’événement et en repart vers l’Inde du Sud, gardant au coeur le souvenir de Marie, mère du Verbe et de l’Église et son témoignage oral, témoignage de vraie « mère de mémoire »[2] recueilli par Jacques le Mineur, Jean et Luc sur l’enfance de Jésus, le sfar d’talioutha que nous appelons l’évangile de l’enfance. Cet Évangile de l’enfance où se développe le récit de la Nativité est d’abord une authentique glorification de l’Incarnation de Miséricorde[3] dont le grand mouvement, selon la théologie des textes les plus chers aux judéo-chrétiens, culmine à la croix de la Passion. Or, la Miséricorde, totalement absente du « Petit Véhicule » – appellation péjorative du bouddhisme initial par les tenants du Mahayana – est précisément l’un des points clés qu’introduira dans le bouddhisme, à compter du IIIe siècle, le « Grand Véhicule », en la personne du bodhisattva Avalokitesvara, lequel prendra dans le bouddhisme chinois la figure féminine de Guanyin”.
(p.55-57)
“Il était de plus en plus clair que le problème principal que rencontraient les archéologues chinois était leur ignorance à peu près totale du christianisme des origines, voire d’un fonds élémentaire de textes chrétiens, à commencer par les Évangiles”. (p.43)
Photo de 2009 (avant sablage) – partie gauche haute
Extrait 2 : (p.77-81)
CHAPITRE V
SIGNATURE ET LECTURE JUDÉO-CHRÉTIENNES DES BAS-RELIEFS DE LA PAROI DE KONG WANG
“Pouvais-je être vraiment sûr de l’origine et donc du sens du message que me semblait avoir offert le sculpteur à celui qui observerait les bas-reliefs de Kong Wang Shan [4] ? Il n’y avait aucune inscription, pas de « légende »à ces images, qui eût permis une attribution initiale exacte, par-delà les aléas de la tradition orale et les siècles. Or, cette signature était là ; il me fallait simplement la découvrir.
Un sceau sur la falaise, mais de quelle origine ?
Tandis que j’examinais avec un soin redoublé la photographie des deux premiers personnages, en usant des capacités de traitement d’images de mon ordinateur, je constatai que, vers le bas, ce n’était pas un losange noir qui séparait les deux personnages, mais une zone sombre sur laquelle se laissaient deviner des traits. À première vue, on notait un poteau vertical et une traverse horizontale au bout de laquelle figurait un triangle, la pointe dirigée vers l’extérieur. Il importait d’identifier ce qui pouvait avoir été gravé sur le bras gauche de cette croix et sur le haut, où l’on distinguait des lignes arrondies. Après de longues hésitations, bientôt surmontées grâce à des changements de contraste, il se confirma que le bras gauche de la croix était également terminé par un triangle, lequel dépassait l’épaisseur de la traverse tant vers le haut que vers le bas. Ainsi, la croix tenue fermement de la main droite posée sur sa poitrine par le personnage principal avait les extrémités de sa traverse horizontale de forme triangulaire: ce dessin n’était pas courant dans les croix latines ou byzantines anciennes.
L’étude détaillée des formes visibles (1. en haut du poteau vertical de la grande croix en X qui domine et réunit les deux personnages ; 2. sur la croix en +, taillée devant le premier personnage sur la face avant du rocher) montrait sans erreur possible, pour un spécialiste des inscriptions grecques de l’art paléochrétien, que l’on avait là un signe rho – le R grec – comme on a l’habitude d’en voir sur les sarcophages, proche par sa forme du P latin. Le complète habituellement le signe X – chi grec transcrit ch en écriture latine – avec lequel il présente – X + P – les deux premières lettres du mot XPistos, le Christ en grec, mais seulement à partir du IIe siècle. Or, le X était absent en bas. Et pour cause ! Il eût été très surprenant de voir un monogramme grec associé à une représentation de l’apôtre Thomas, dont la mission se développe entièrement à l’extérieur de l’empire gréco-romain et de tout usage du grec.
Une abréviation commune dans l’Église des origines ?
Mais il me fallut arrêter les discussions que mes amis grecs entamaient pour défendre la thèse, chère à beaucoup d’occidentaux (mais jamais prouvée), d’un usage populaire d’un grec vulgaire répandu en Palestine au temps de Jésus.
Il m’a fallu aussi briser net une seconde discussion que mes amis exégètes entamaient, fâchés que le deuxième personnage tînt dans sa main gauche un rouleau qui aurait pu être un aide-mémoire de textes évangéliques, si on accordait du crédit à mes propositions… Un aide-mémoire dès 65 et en Chine? Pour un apôtre ayant quitté en 51 la Palestine ? Il fallait donc qu’il y en ait eu bien plus tôt dans l’Empire parthe ! Et pourquoi pas fin 51 – quand Thomas repassa par Jérusalem, revenant de Pattala, avant de repartir vers l’Inde du sud ?
L’hypothèse plausible (une évidence à mes yeux) était que Thomas usait, pour prêcher, de la tradition évangélique orale, selon sa forme du Ier siècle, c’est-à-dire avec des textes écrits aide-mémoire comme à Qumrân. L’accompagnait un diacre interprète muni d’un rouleau mémento, en araméen, d’une partie des mémoires des apôtres. L’interprète de Kong Wang, à « Port-touche-nuage », est vêtu d’une robe parthe, il parle donc probablement araméen, et non grec. Or, cette hypothèse était incompatible avec celle, sacro-sainte pour trop d’exégètes, d’une transmission orale sans aide-mémoire écrit – puisque l’écrit évangélique est, selon eux, postérieur à 70 et en grec seulement[5]. Pour eux, donc, s’il y avait un rho grec sur le bas-relief, le rouleau de l’interprète ne pouvait pas contenir autre chose que du grec. Ce devait être une citation des prophéties sur le Christ, d’Isaïe par exemple, en rapport avec la Passion et la croix, donc avec la Septante. Oui, bien sûr! Mais alors, pourquoi la Septante portée par un Parthe venant de l’Empire parthe, où elle est inconnue, puisque l’on y dispose abondamment des textes hébreux ou de leurs targumim[6] araméens – en écriture babylonienne carrée ou plus cursive ? À moins qu’elle ne servît à valider le serment dont la main levée est signe ? Les questions succédaient aux questions… Peut-être cette inscription n’était-elle pas grecque ? N’aurions-nous pas affaire à une abréviation commune dans l’Église des origines ?
Une signature judéo-chrétienne en araméen ?
Ce P, rho grec, pour tout spécialiste de l’Eglise des origines, c’était un faux problème, lié à une mauvaise lecture. Nous étions face à un monde parlant et écrivant beaucoup, comme à Qumran, en araméen ou en hébreu. Il s’agissait donc d’un qof et non d’un rho. Les distinguer est facile, grâce aux deux inflexions portées sur la demi-lune tracée en haut et à droite du trait vertical. Ce qof était une lettre-signe pour les judéo-chrétiens; les multiples graffitis du Ier et du IIe siècle en Palestine le montrent. Les judéo-chrétiens l’emploient seule ou avec la barre horizontale, sous la demi-lune et formant croix. La barre fait de ce qof le serpent d’airain resplendissant au désert, lové sur son pilier et portant le salut à ceux qu’ont mordus les reptiles qui, tapis sous le sable du désert, se gardent du soleil trop brûlant. Jésus avait pris cette image de la tentation du peuple hébreu au désert pour montrer à ses disciples comment Lui-même aurait à être élevé aux yeux de tous sur la croix pour apporter le pardon des péchés. Mais, pour tout lecteur chrétien de l’araméen, ce serpent élevé sur l’arbre de la croix, c’est aussi le qof initial du mot qyamtha – résurrection”.
(p.77-81)
EXTRAIT 3 :(p.96-97)
“Une pièce capitale
Voilà ce que dit cette pièce capitale de notre dossier qui n’est pas étrangère, par ailleurs, à l’importance que revêtent alors pour les souverains chinois les relations de l’Empire avec le monde extérieur – ce qui ne sera plus le cas à l’ère où les Européens se lanceront sur les mers et débarqueront en Chine.
« Une tradition répandue veut que Mingdi eût un songe qui lui fit voir un homme blond [doré?], grand et dont le sommet de la tête était auréolé. L’Empereur questionna sur ce songe une foule de conseillers et l’un d’eux lui dit qu’en Occident existait un dieu dit « lumineux » [ou « l’Homme-Lumière« ]. Son corps avait huit zhang [huit empans, soit deux mètres environ] et son teint était doré [ou « comme l’or »].
L’Empereur, désireux de s’enquérir de la vraie doctrine, dépêcha un envoyé au pays de Tianzhu pour qu’il s’informât des préceptes de l’illuminé. C’est à partir de cette époque que parvinrent dans l’Empire du Milieu peintures et statues, et Ying, prince de Zhu, commença à avoir foi en cette voie [ou en la personnalité qui la prêchait] et, grâce à cela, l’Empire du Milieu la reçut avec estime. Plus tard, l’empereur Huan [146-167] en devint dévot et s’adonna à la pratique de ses rites, offrant souvent des sacrifices à Fo et à Laozi [7]. Peu à peu les gens acceptèrent cette voie et furent bientôt nombreux à en pratiquer les rites. »
Quel est cet homme « doré » (ou « comme l’or ») ? Comment faut-il comprendre ce « Dieu dit « illuminé » » (ou « de lumière », voire « transfiguré ») ? En sanscrit, on songe à l’adjectif « bouddha »[8]. Mais, dans ce cas, s’agit-il du Bouddha Gautama ou seulement de l’interprétation qu’a pu faire de cette figure radieuse un homme du Ve siècle comme Fan Ye ?
Quant à la « Voie », désigne-t-elle la doctrine, ou la personne portant cette doctrine vers l’an 65 ? Le mot chinois shu signifie « savoir faire, art, technique, science », certes, mais il peut aussi désigner la personne qui en fait montre. Shu peut être l’équivalent de shushi et signifier notamment « magicien, diseur de bonne aventure, alchimiste ». Shi implique « homme cultivé, lettré, sage » ; il est propre à faire référence, et ce ne peut être que par souci de précision, à un homme tels ceux que dans l’Empire parthe on disait des « mages ». Le mot « voie » s’ajusterait alors, non à la réalité chinoise du dao (même s’il « ne peut être appréhendé par l’esprit discursif, est manifeste dans le devenir naturel et s’impose à l’homme en le rendant à lui-même »[9]), mais à la réalité du Christ qui se désignait lui-même comme « la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6)[10]”.
(p.96-97). Introduction biographique.
[1] Le port d’Apologos, selon les Grecs, à l’embouchure de l’actuel Chatt-el-Arab.
[2] Les « mères de mémoire » étaient, dans les communautés judéo-chrétiennes, des veuves qui veillaient mot à mot à la terminologie exacte des témoignages des apôtres pour garder les propos saints qui étaient tenus par les prédicateurs.
[3] La représentation de la Nativité sur la paroi répond très exactement au chapitre XI de L’Ascension d’Isaïe, texte judéo-chrétien du Ier siècle: « Il arriva tandis qu’ils étaient seuls que Marie regarda soudain de ses yeux et elle vit sur elle un petit enfant et elle fut bouleversée, et son ventre se retrouva comme auparavant, avant qu’il eut conçu. Lorsque son mari Joseph lui dit: « Pourquoi es-tu bouleversée ? », ses yeux s’ouvrirent et il vit l’enfant et il glorifia le Seigneur, car le Seigneur avait pris soin de son lot ». Commentaire de Dom Lafond, osb (Vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle, à paraître) : « On peut interpréter cet étrange récit en disant que, par sa naissance miraculeuse, Jésus préserva la virginité de sa Mère en disparaissant de son ventre et apparaissant aussitôt sur elle. La recommandation vise à préserver le secret de la naissance virginale qui fait partie du secret messianique attesté par les Évangiles. Voir le texte de Matthieu araméen 1,24-25 : « Joseph prit auprès de lui son épouse, sans la comprendre, jusqu’au jour où elle enfanta un fils et qu’elle lui donna le nom de jésus. » » (Cf. cahier photos, 7.1 et 7.2).
[4] Shan: paroi, falaise en chinois; d’où Kong Wang Shan ou paroi de Kong Wang.
[5] Claude Tresmontant, parmi beaucoup d’autres, a montré que les Évangiles ont été mis par écrit sous la forme de dossiers de notes pris par les disciples du Christ selon ses paroles, bien avant d’être traduits en grec de synagogue avec le même lexique que la traduction grecque de la Bible hébraïque (la SeptantePeshitta, et l’occidental un peu retouché, Peshitto, sont des témoins très fidèles, aux variantes dialectales près, de ce texte-source oral, ou Pshytta (« l’original »: les anciens manuscrits gardent des signes de liaisons permettant de restituer les perles et colliers oraux originaux). Voir ANNEXE 1.
[6] Traduire la Bible est devenu après l’Exil une nécessité. Israël a d’abord entendu son II)ieu dans sa langue ancienne, l’hébreu. Quand il a commencé à perdre l’usage de l’hébreu pour parler l’araméen, il a fallu traduire la Parole dans les synagogues: c’est l’origine de textes araméens pour la lecture synagogale en Mésopotamie puis, plus tardivement, avec des targumim – paraphrases expliquant l’Écriture. Enfin le développement de la diaspora juive en Égypte a imposé le passage de l’hébreu au grec, ce fut la Septante.
[7] Bouddhisme et taoïsme finirent par répondre aux aspirations religieuses des Chinois, ce constat le confirme. Le rédacteur du Houhanshou ignore le christianisme; ce qu’explique très bien le sort infligé au prince Ying et justifie l’observation, au Ve siècle, de Fan Ye selon laquelle « la Voie [avait] été fermée », en fait « récupérée ».
[8] On dit en français une personne brillante, une santé éclatante, un visage lumineux de vieux moine. Avec l’adjectif galia, l’araméen insiste davantage sur l’illumination venant de l’intérieur que révèle l’« ouverture » du visage à travers lequel on accède au cœur. C’est un don de l’Esprit Saint qui est appelé sur chaque participant à la liturgie eucharistique par le prêtre, pour que tous reçoivent avec des visages rayonnants (appé galiatha) la « communion » aux mystères (cf. 2 Cor 3,18) ; elle permet la participation mystique à la liturgie céleste, par-delà le voile des réalités terrestres. On peut penser à l’expression bouddhique chinoise xinjing : « le cœur, miroir qui illumine toute chose » (Dictionnaire Ricci).
[9] Cf. Dictionnaire Ricci.
[10] Si Thomas a reconnu son Seigneur et son Dieu en Jésus ressuscité portant les marques de la Passion, l’empereur est invité à reconnaître, quand il viendra à Luoyang, l’envoyé du Seigneur qui lui apparaît. Cette reconnaissance sera facilitée et confirmée par la ressemblance physique de Thomas avec Jésus, ressemblance sur laquelle les traditions orientales s’accordent.

